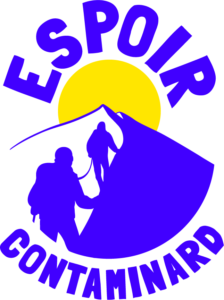Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
Robet Rey : J’ai repris l’hôtel La Gélinotte, que j’avais hérité de mes parents. J’ai fait ça pendant vingt-cinq ans. Avant, j’avais appris le métier ailleurs, dans plusieurs hôtels : à Talloires, à Megève… J’ai toujours travaillé dans l’hôtellerie.
Et puis un jour, j’en ai eu marre. Il y a eu un déclic. Un accident de voiture.
Je descendais chercher le pain, le matin, avec ma Méhari. Un jeune touriste m’est rentré dedans. Il ne savait pas quoi faire, moi j’étais pressé… J’ai pris sa carte grise, je lui ai dit de prévenir son père et qu’il passe à la maison.
Le père est venu, c’était un peu tendu et il m’a sorti une phrase dont je me souviendrai toute ma vie : “De toute façon, heureusement qu’on est là pour vous faire vivre.”
Ça m’a profondément agacé. Vraiment. À partir de là, j’ai mis l’hôtel en gérance. Et quelques années après, j’ai vendu.
Ensuite, j’ai acheté Sur Les Roches. J’ai retapé un chalet d’alpage, j’ai pris des chèvres. Je montais en trial, je redescendais les fromages que je vendais dans le village. Je ne gagnais pas vraiment ma vie, c’était surtout pour le plaisir.
Puis je suis parti dans le Midi avec ma femme, pour pouvoir laisser les chèvres dehors toute l’année. J’ai acheté dans le Lot-et-Garonne. Ça marchait, mais pas assez pour en vivre correctement. Alors un jour, j’ai dit à ma femme : “On va faire ce qu’on sait faire, accueillir les gens.” On a transformé la ferme en restaurant à la ferme. Et là, ça a très bien marché.
Mais au bout d’un moment, ma femme s’ennuyait de nos enfants… alors on est revenus. J’ai juste gardé les ruches. J’ai toujours eu des abeilles. Toute ma vie, j’ai fait du miel.
Et puis le ski… J’ai toujours skié, depuis l’école. À l’époque, j’étais très copain avec François Bonlieu. On skiait ensemble. J’avais l’esprit de compétition : je me disais que là où il passait, je devais passer aussi. Ça m’a formé.
J’ai fait un peu de compétition, en descente et en géant. Je me souviens d’une course avec l’instituteur Guffond, j’avais quatorze ans. J’ai gagné le saut, la descente et le géant. Lui avait gagné le slalom. On nous emmenait en compétition dans un tube Citroën… on voyageait là-dedans.
Mon frère faisait du saut. Petit à petit, je m’y suis mis aussi. Je suis entré dans l’équipe nationale. On faisait la tournée : Chamonix, Megève, Les Contamines, Morzine… je crois. J’ai progressé. Mon frère est devenu champion de France, recordman de France. Et moi, je me suis dit : “Je vais faire mieux que lui.”
Je suis devenu champion de France à mon tour. Et je lui ai pris son record. Il avait sauté 110 mètres. Moi, j’ai fait 129. J’ai gardé le record pendant dix-sept ans.
J’ai fait les Jeux olympiques de Squaw Valley en 1960, puis les championnats du monde à Zakopane deux ans plus tard. Et puis les jeunes ont commencé à pousser derrière. Et comme je n’aime pas perdre… j’ai arrêté.
Selon vous, quel est aujourd’hui le principal enjeu collectif à résoudre pour redonner un cap clair aux Contamines ?
Robert : Je regrette les années 60. Aujourd’hui, tout va trop vite.
On ne devrait pas restreindre le passage dans le village comme on le fait avec des chicanes. Le rétrécissement du pont de la scierie aussi, par exemple… Ça fait soixante-dix ans que je conduis, je n’ai jamais vu un accident à cet endroit. Et maintenant, ça n’arrête pas. Il faut quand même se poser des questions.
Moi, j’ai travaillé avec le tourisme, hein. J’ai gagné ma vie avec. Je ne crache pas du tout dessus. Mais trop, c’est trop. On veut continuer à construire des appartements à louer à la semaine alors que la plupart sont déjà vides et que les jeunes n’arrivent pas à se loger.
À l’époque, j’étais au syndicat de l’hôtellerie des Contamines. On avait trente hôtels dans le village. Rien que dans le hameau, on était trois hôtels ! Et tout le monde gagnait sa vie.
Aujourd’hui, ce n’est plus la même clientèle. On se focalise sur des gens qui dépensent très peu, contrairement à la clientèle hôtelière d’avant. Il faut recréer des hôtels et retourner dans une logique à l’année.
Mais ça demande une dynamique générale. En fin de saison, on trouve pas un restaurant d’ouvert dans le village. Une fois, j’ai vendu une moto à un gars. Pour le remercier, j’ai voulu l’inviter au restaurant. Il n’y avait rien d’ouvert. Rien. À l’époque, nous, on habitait dans l’hôtel. On était ouverts toute l’année. Il y avait de la vie.
Alors franchement, ça ne sert à rien de construire un bâtiment dans le centre pour rajouter encore des appartements peu occupés, pendant que les gens du pays ne peuvent pas se loger.
Dans votre vie quotidienne ici, quel est l’exemple le plus concret d’un problème ou d’un manque qui doit absolument être amélioré ?
Robert : Moi, je suis en fin de vie. J’essaie de pousser mes enfants à s’intéresser à la vie de la commune, à y adhérer. Mais moi, personnellement, il ne me reste plus grand-chose à vivre ici. Je me sens moins concerné qu’avant.
Le vrai problème, pour moi, c’est cette station qui ferme dès la fin de la saison. Tout s’arrête. Il faudrait par exemple que les restaurants puissent se mettre d’accord, s’organiser, pour qu’il y ait toujours au moins quelque chose d’ouvert. C’est essentiel.
Et puis, regarde… tu es venu en voiture ? La route du hameau est en très mauvais état. On a droit à des rustines tous les ans, mais ça ne tient jamais bien longtemps. Il faut aussi se réintéresser aux hameaux. À la vie des gens, à ce qu’ils vivent au quotidien.
Aujourd’hui, il y a plus de monde, plus de trafic. Donc il faut vraiment entretenir, suivre, rénover efficacement.
Qu’est-ce qui vous a convaincu de soutenir notre démarche plutôt qu’une autre ?
Robert : J’adhère à ce projet parce qu’on fait le même constat et qu’il est cohérent avec ce que je défends depuis longtemps.
Qu’est-ce qui fait, pour vous, la singularité et la force de notre station-village ?
Robert : Il y a deux saisons et on a de la chance d’avoir un vrai été qu’on peut encore vraiment faire vivre et développer. Et je trouve que c’est une chance d’être un fond de vallée. Les gens ne font pas que passer, ils s’arrêtent.
Je le dis aussi par expérience. Avec la moto, je vois bien comment ça se passe. Je ne suis pas sûr que, si on était juste sur un axe de passage, les gens s’arrêteraient forcément.
Quand on va dans la vallée de Beaufort, par exemple, on va manger à la Ville des Glaciers… mais on ne s’arrête pas ailleurs.
Si on vous demande de citer un seul endroit aux Contamines, ce serait lequel et pourquoi ?
Robert : Sur Les Roches, sans hésiter, parce que quand j’ai fait ce changement dans ma vie, j’ai redécouvert Les Contamines. Quand j’étais dans l’hôtellerie, il faut bien le dire, c’était le travail tout le temps. Sans arrêt. Je n’avais pas le temps de regarder les montagnes.
Là-haut, je m’occupais de mes chèvres. Je m’asseyais dans l’herbe, avec une paire de jumelles, et je regardais les montagnes.
Le plus beau coin des Contamines, c’est forcément là où on monte en alpage. Je pense que tout le monde dira la même chose. Quand j’étais jeune, avec mon père, on allait à Armancette. On couchait dans un chalet d’alpage, et on allait le lendemain à la chasse. Ce sont des souvenirs qui n’ont pas de prix.
Comment imaginez vous le village dans 50 ans si on ne change rien ?
Robert Si ça reste comme maintenant, je pense que beaucoup de gens vont finir par s’en aller. Il y a un ras-le-bol, clairement. Ça fait quinze, vingt ans que ça ne bouge pas énormément et que ça ne va pas dans le bon sens.
Si vous aviez carte blanche pour un projet utile à tous, lequel serait-ce ?
Robert : À un moment, j’avais pensé à une piste de luge d’été. Par exemple à la place de l’ancien téléski du Grand Nivorin. Après, il faut voir comment ça s’intègre dans le paysage, évidemment. Mais ça pourrait passer, d’un côté à l’autre de la crète. Je sais que ce genre d’équipement, ça marche très bien.